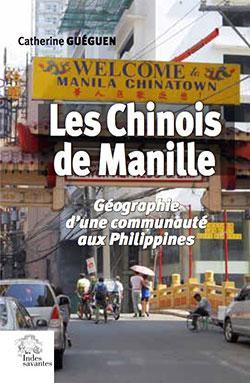Bien que la communauté chinoise soit présente dans tout l’archipel philippin, le quartier chinois de Manille, Binondo, reflète particulièrement l’évolution de ce groupe. Les aléas de l’histoire – la période maoïste ou encore les accords multilatéraux récents entre l’État philippin et la Chine continentale – se traduisent par des freins ou une accentuation des mobilités chinoises vers les Philippines. Manille reste le premier foyer d’accueil de ces populations chinoises dont les vagues migratoires s’inscrivent désormais de manière différenciée dans cette agglomération de 14 millions d’habitants.
L’emprise spatiale de cette communauté chinoise dont le profil se diversifie est aussi soumise au droit local et au statut des personnes. Ce sont désormais les interactions entre Philippins d’ascendance chinoise et les nouveaux migrants transnationaux qui dominent ; ces liens tout comme les structures associatives chinoises locales témoignent d’une recomposition communautaire sélective.
L’étude, en interrogeant les espaces, leurs fonctions et la gouvernance urbaine permet d’entrevoir les stratégies d’ajustement des populations chinoises sur le moyen et le court terme dans un espace-temps où les transformations du paysage urbain s’accélèrent dans un contexte économique favorable. Interroger les implantations spatiales des populations chinoises revient à comprendre leur cheminement dans l’histoire, la géographie et l’économie des Philippines depuis la fin de la seconde guerre mondiale.